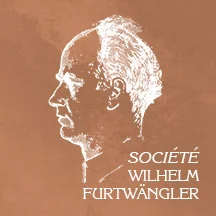Ce contenu est réservé aux abonnés
Décennie de programme : 1941-1950
Concert du 22 mars 1942
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert du 8 mars 1948, Watford
Le 4 avril 1948, Furtwängler écrivait à Ludwig Curtius « qu’il reprend contact avec le monde anglo-saxon dans des conditions extérieurement insuffisantes ». Insuffisantes ou pas, les circonstances étaient certainement peu banales : il était le premier chef allemand — non exilé — à diriger en Grande Bretagne après la Seconde Guerre Mondiale (Clemens Krauss y était venu en visite en 1947 avec l’Opéra National de Vienne, mais était autrichien). En 1948, il y fit quatre séjours, donnant vingt-et-un concerts avec quatre orchestres différents, dont huit furent retransmis, en tout ou partie, par la BBC. Il dirigea également le seul cycle complet qu’il ait jamais donné des symphonies de Beethoven, l’Héroique étant même télévisée. S’y ajoutent un long entretien radiophonique avec le journaliste de gauche Henry Noel Brailsford et des séances d’enregistrement pour HMV et Decca.
En 1938 Furtwängler déclara à Fred Gaisberg que sa récente expérience avec le Philharmonique de Londres l’avait convaincu qu’il pouvait en tirer des résultats comparables à ceux du Philharmonique de Berlin. Mais, durant sa première visite de 1948, s’étalant sur quatre semaines, il se trouva à la tête d’un Philharmonique de Londres qui avait perdu son fondateur Beecham et pas encore vu son sort ravivé par Boult. Néanmoins, et sous un angle plus positif, toute l’inquiétude, qu’il aurait pu ressentir au sujet de son accueil dans un pays encore ennemi voilà peu, se trouva balayée lorsque les musiciens se levèrent spontanément et applaudirent à son arrivée 1.
Les exigences de répétitions ont dû être considérables. Le programme de leurs dix concerts englobaient les quatre Symphonies de Brahms, et les Septième et Neuvième de Beethoven, plus treize autre œuvres, pour la plupart n’apparaissant qu’une seule fois sur la série. Le premier concert affichait la Fantaisie sur un thème de Tallis de Vaughan Williams — qu’il avait donnée en Allemagne dans les années vingt — tandis que L’Horloge de Haydn et En Saga de Sibelius étaient joués dans un concert au bénéfice de la caisse de retraite du LPO. Et, en sus de tout ça, il enregistra la Deuxième Symphonie de Brahms avec le LPO, et — première rencontre avec le Philharmonia — la scène finale du Crépuscule des Dieux.
La visite inclut des concerts à Birmingham et Leicester, et — plus surprenant peut-être — en banlieue de Londres, à Watford et Wimbledon, qui seraient ravis d’applaudir de nos jours une telle star de la baguette ! Le Watford City Hall accueillit tous les genres de musique, mais aujourd’hui il demeure essentiellement dans les mémoires pour avoir été le lieu de nombreux enregistrements classiques.
Les programmes étaient une combinaison typique de chefs-d’œuvre reconnus du répertoire allemand et d’ouvrages plus récents et plus exigeants. Furtwängler manifestait guère d’enthousiasme pour Mahler, mais se montra actif pour défendre son œuvre alors peu connue en Grande Bretagne ; nombreux furent ceux qui dans le public de Watford ont dû découvrir les Lieder eines fahrenden Gesellen. Eugenia Zareska devait apparaître peu après à Covent Garden, avant de s’établir plus tard à Londres et de prendre la nationalité britannique.
Les comptes-rendus de la presse (la plupart anonymes), compilés par John Squire, en 1985, dans l’étude Furtwängler en Grand Bretagne 2, ne font pas allusion au récent conflit : on a l’impression que le monde musical était soulagé de revenir en période de paix et de tourner ses regards vers l’avenir. Sur le plan musical, Furtwängler suscita des opinions divergentes, comme elles l’ont toujours été en Grande Bretagne, où d’aucuns lui reprochaient une subjectivité excessive. Mais le Musical Review était de son côté, trouvant que « sa principale caractéristique demeure inchangée : son pouvoir de percevoir une œuvre comme un tout musical, et tout autant comme un microcosme de l’expérience humaine — même si ses moyens techniques ne sont pas toujours à la hauteur pour amener le London Philharmonic à traduire totalement ses idées. »
Roger Smithson, Juin 2023

Eugenia Zareska
- Raconté par Robert Meyer (1920-2016), contrebassiste au LPO puis au Philharmonia, dans Musical Reminiscences. https://robertmeyer.wordpress.com/2007/04/20/wilhem-furtwangler-conductor
- Éditée par la Wilhelm Furtwängler Society UK, 1985.
Concert du 14 novembre 1943
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert à Rome du 6 avril 1947
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert du 11 janvier 1942
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert du 13 février 1942 – Variations sur le thème d’un mécontent
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert de Berlin du 23 février 1948
Ce n’est pas n’importe quel concert que celui dont voici le facsimilé du programme. Il voit la création de l’imposante Deuxième Symphonie de Furtwängler sous la baguette du compositeur.
Il n’entre pas dans le cadre de cette brève présentation d’analyser une œuvre aussi complexe. Son caractère romantique et même tragique, son écriture qui emprunte son langage à Brahms, Bruckner et même Wagner, son orchestration touffue, tout concourt à éloigner de nous ce qui était déjà très « daté » à l’époque.
Contentons-nous de mettre en avant quelques points de détail.
Nous ignorons pourquoi cette création se tient à l’Admiral-Palast, en secteur soviétique, et non dans la salle devenue habituelle pour les Berliner : le Titania, en secteur américain.
Au denier moment, du moins le 23 — la feuille volante que nous avons placée en début de facsimilé — la 39e Symphonie de Mozart a laissé place au Concerto grosso en ré majeur de Haendel, sans doute moins chargé d’affect.
Pour deux saisons l’Orchestre Philharmonique de Berlin confia la couverture de ses programmes au peintre Ferry Ahrlé (1924-2018). Cela nous vaut un portrait stylisé de Furtwängler particulièrement réussi.
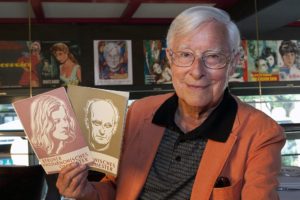
Concerts de novembre 1948 à Paris
La France — en l’occurrence Paris — fut le premier des pays qui avaient eu à souffrir de l’occupation allemande à accueillir Furtwängler après guerre. Dès janvier 1948, le chef se produisit avec le prestigieux et vénérable Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Depuis deux ans le chef titulaire en était André Cluytens, qui avait succédé à Charles Munch en 1946, la présidence appartenant de droit au directeur du Conservatoire supérieur, le compositeur Claude Delvincourt.
En novembre de la même année, Furtwängler revint pour une autre série de trois concerts, toujours au Théâtre des Champs Élysées — qui a pris la place de l’ancienne et historique salle du Conservatoire de la rue Bergère, dénoncée depuis des lustres comme trop exiguë et indigne d’une métropole comme Paris. Notons que ce concert vint quelque jours après le Requiem allemand de Stockholm.
Programme on ne peut plus classique. Rien à ajouter donc, sauf le nom du Premier violon solo de l’orchestre qui, sans doute, assura le grand solo dans la Quatrième de Schumann : Roland Charmy.

Un grand merci à l’adhérent qui nous a procuré ce programme.
Concert de Berlin des 20-22 décembre 1950
On ne compte pas les très nombreuses Neuvième de Beethoven que Furtwängler dirigea à Berlin de 1920 à 1942, notamment avec le Chœur de Bruno Kittel.
À partir de son retour, les Neuvième se multiplièrent à Vienne (4 séries), à Bayreuth (2), à Salzbourg, à Lucerne (2), en Italie… mais se firent bien rares à Berlin. Problème de salle ? Il est vrai que la scène du Titania était exigüe. Problème de chœur ? Celui de la Cathédrale Sainte-Edwige a fait les beaux soirs de nombreux concerts et a rempli son office dans de beaux enregistrements. En tout cas pas un problème de solistes. Ceux rassemblés pour cette série de concerts de décembre 1950 sont de tout premier ordre, même si le casting apparaît a priori un peu hétérogène.
Le fascicule est lui-même intéressant. En marge de la longue analyse de l’œuvre sous la plume de P.W. — comprenez Peter Wackernagel — on remarque trois publicités de majors du disque :
– en page 2 : Decca, qui a signé des grands noms de la baguette, y compris Furtwängler, mais lequel n’a alors commis qu’un disque sous ce label : celui de la 2e Symphonie de Brahms avec le Philharmonique de Londres,
– en page 8 : Deutsche Grammophon Gesellschaft ; publicité générale qui annonce surtout un catalogue à venir en disques longue durée, et pour qui Furtwängler gravera quelques disques un an plus tard,
– en page 11 : Electrola (du groupe EMI), qui n’évoque pas les disques publiés avec Furtwängler — qui pourtant se multiplient depuis 1947 —, mais une Neuvième de Columbia en 78t, sans citer chef et orchestre, qui se trouvent être… Herbert von Karajan et le Philharmonique de Vienne.
Enfin, pour les gourmands, signalons que les chocolats et pralines du “petit Maure” de Sarotti, du dos de couverture, existent toujours.