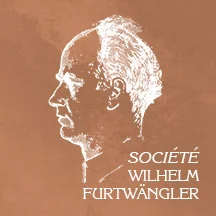Ce contenu est réservé aux abonnés
Décennie de programme : 1931-1940
Concert du 14 octobre 1940
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert du 8 février 1932
Ce contenu est réservé aux abonnés
Potsdam, 27 juin 1938
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert à Édimbourg du 7 décembre 1935
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concert de Varsovie du 22 janvier 1936
Ce contenu est réservé aux abonnés
Festival pour le centenaire Brahms – Vienne 1933
Ce contenu est réservé aux abonnés
Concerts de Berlin des 3-5 avril 1938
Quelques mots sur ce programme, non sur son contenu — du pur Beethoven, sans surprise — mais sur ce qui va avec.
Le fascicule est accompagné de deux feuilles volantes. Le feuillet vert annonce deux concerts à venir à Berlin, mais avec le Philharmonique de Vienne. C’est qu’il vient de se produire un événement décisif : le Reich vient d’annexer l’Autriche, qui entre ainsi dans le giron de la grande Allemagne. Ces concerts font partie du processus d’intégration, mais masquent une autre réalité : Furtwängler, à la demande des philharmonistes, intervient en haut lieu pour que les Wiener Philharmoniker soient traités « à part ».
Le feuillet rose bouscule légèrement l’ordre des pièces : Léonore II sera jouée après la 4e Symphonie et non avant. Furtwängler le faisait couramment à cette époque, notamment avec Coriolan, considéré comme sommet de tension du concert. Cela nous apparaît curieux, habitués que nous sommes à entendre une ouverture en début de concert, et oublieux que nous sommes de ce qu’une ouverture d’opéra, dès lors qu’elle en est détachée, devient une page symphonique comme une autre, à placer au meilleur moment en fonction de sa portée musicale.
Enfin, on notera la présence de trois portraits du chef : une photo officielle, et le portrait en dessin de chacun des labels de disques : Electrola, encore filiale d’EMI, et Deutsche Gramophon, distribué par HMV en Allemagne et plus connu sous Polydor à l’étranger.

Furtwängler, à cette époque, avec ses trois Konzertmeister berlinois, Erich Röhn, Hugo Kolberg et Siegfried Borries.
Concert de Munich du 7 juin 1935
Le programme de ce concert peut paraître anodin — Egmont, la Pastorale, la Cinquième — si l’on oublie quelle signification particulière il représente pour Furtwängler. Démissionnaire de tous ses postes fin 1934, il remonte pour la première fois au pupitre de son Philharmonique le 25 avril 1935 avec ce « tout-Beethoven », qui est une profession de foi. Les Berlinois, mais aussi le corps diplomatique présent, ne s’y trompent pas et font de cette soirée un événement : huit rappels et l’intervention de la police municipale pour obtenir que l’on vide les lieux. Quelque jours après, et le concert ayant été re-programmé (comme le premier au bénéfice du Secours populaire), Furtwängler se fait piéger en découvrant la brochette en uniforme qui occupe le premier rang ! Première de nombreuses récupérations politiques, auxquelles il aura du mal à échapper.
Les quelques concerts qu’il donne en tournée avec son orchestre présentent la même affiche, tel celui-ci donné à Munich dans le cadre du Festival d’été. Le concert est donné, non dans la Salle des congrès, mais dans la gigantesque « Halle 1 », là-même où Mahler avait créé sa 8e Symphonie vingt-cinq ans plus tôt.
Pour son grand retour en mai 1947, il reprendra ce même programme…